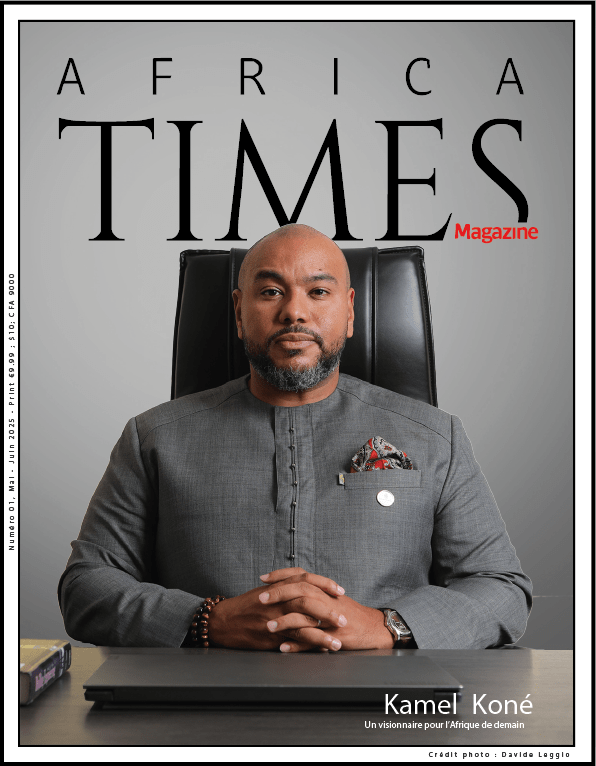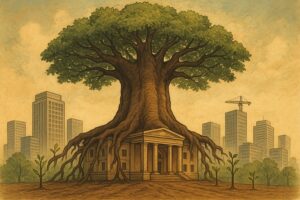En janvier 1946, dans un laboratoire militaire du New Jersey, un faisceau radar est envoyé vers la Lune, rebondit, et revient sur Terre. L’événement — connu sous le nom de Project Diana — marque la première communication radio interplanétaire et ouvre, sans le savoir, la voie à l’industrie spatiale qui pèse aujourd’hui plus de 500 milliards de dollars. Derrière ce calcul de trajectoire lunaire, un homme discret mais visionnaire : Walter Samuel McAfee.
Ce physicien afro-américain, longtemps ignoré dans les récits officiels, illustre une vérité fondamentale de l’économie de l’innovation : la croissance ne naît pas uniquement dans les conseils d’administration, mais aussi dans l’ombre des laboratoires.
Né en 1914 à Ore City, Texas, McAfee grandit dans une Amérique ségréguée où la mobilité sociale des Afro-Américains est quasi inexistante. Pourtant, sa famille croit au pouvoir de l’éducation : tous ses frères et sœurs obtiennent un diplôme, un exploit rare à l’époque.
En 1934, il décroche un baccalauréat en mathématiques à Wiley College, puis une maîtrise en physique théorique à l’Ohio State University. Dans un pays encore frappé par la Grande Dépression, ces diplômes ne représentent pas seulement un accomplissement académique : ils sont un capital intellectuel prêt à être investi dans la transformation technologique.
En 1942, McAfee rejoint l’Army Signal Corps de Fort Monmouth, un centre de recherche militaire stratégique. Recruté sur la base de ses compétences (sans photo, pour éviter le filtre discriminatoire des ressources humaines), il intègre un environnement où la science sert directement l’économie de guerre… et bientôt, l’économie spatiale.
Lorsque le Project Diana démarre, il faut calculer avec précision la vitesse de rotation et la distance Terre-Lune pour que le signal radar atteigne sa cible et revienne. C’est McAfee qui réalise ces calculs critiques. En réussissant cet exploit, il ne se contente pas de démontrer une prouesse scientifique : il prouve que les communications au-delà de l’atmosphère sont possibles, posant la première pierre des satellites de télécommunications, du GPS et des flux mondiaux de données — piliers de l’économie numérique.
Si l’on replace son œuvre dans une perspective économique, McAfee est un exemple type de ce que Joseph Schumpeter appelait l’innovation radicale : une percée technologique qui crée de nouveaux marchés entiers.
Le rebond radar sur la Lune n’a pas seulement ouvert la voie aux missions spatiales ; il a aussi initié un cycle d’investissements massifs dans l’aérospatiale, les télécommunications et la défense. Aujourd’hui, ces secteurs génèrent des centaines de milliards de dollars et des millions d’emplois qualifiés à travers le monde.
En termes économiques, McAfee a contribué à créer un effet multiplicateur : une découverte scientifique produisant des retombées économiques dans des industries qui, à l’époque, n’existaient même pas.
En 1949, grâce à une bourse Rosenwald, McAfee obtient son doctorat en physique à Cornell University, sous la direction de Hans Bethe, futur prix Nobel. Puis, en 1956, une bourse prestigieuse de l’armée américaine lui permet d’effectuer un post-doctorat en radioastronomie à Harvard.
Ces étapes montrent que l’innovation repose sur l’investissement continu dans le capital humain. Dans une économie moderne, le savoir scientifique est une ressource rare et stratégique, capable de générer des rendements bien supérieurs aux investissements initiaux.
Sur 42 ans de carrière à Fort Monmouth, McAfee gravit les échelons jusqu’au grade GS-16, le plus élevé pour un civil, devenant le premier Afro-Américain à atteindre ce niveau. Parallèlement, il enseigne à Monmouth College, transmettant ses connaissances à la nouvelle génération.
D’un point de vue économique, il agit à la fois comme innovateur (créateur de valeur) et diffuseur (multiplicateur de valeur), en assurant que ses découvertes nourrissent un écosystème de chercheurs et d’ingénieurs.
Si sa contribution a longtemps été oubliée, elle est aujourd’hui reconnue. Plusieurs institutions portent son nom, et il a été intronisé au Hall of Fame du United States Army Materiel Command. Mais son véritable héritage est plus vaste :
- Les systèmes GPS qui pilotent la logistique mondiale.
- Les communications satellites qui soutiennent la finance et le commerce international.
- L’essor de l’économie spatiale, estimée à 1 000 milliards $ d’ici 2040.
Sans le calcul précis de McAfee en 1946, ces infrastructures auraient peut-être vu le jour bien plus tard, retardant ainsi des décennies de croissance dans plusieurs secteurs.
L’histoire de McAfee nous rappelle trois enseignements clés pour les décideurs économiques :
- Investir dans la science fondamentale : Les retombées économiques des découvertes de laboratoire peuvent dépasser de loin l’investissement initial, même si elles ne sont pas immédiatement visibles.
- Valoriser le capital humain diversifié : L’inclusion n’est pas seulement une question de justice sociale, c’est aussi un moteur d’innovation.
- Relier innovation et marché : Les percées scientifiques doivent être intégrées dans des chaînes de valeur pour générer un impact économique.
En faisant rebondir un signal radar sur la Lune, Walter Samuel McAfee a non seulement marqué l’histoire de la science, mais il a aussi amorcé un cycle de création de valeur qui perdure encore aujourd’hui.
Dans l’économie moderne, où la concurrence se joue sur l’innovation, il incarne l’idée que les avancées majeures proviennent parfois de lieux et de personnes inattendus. Son parcours, de la ségrégation texane aux sommets de la recherche militaire américaine, illustre comment un esprit visionnaire peut transformer une découverte scientifique en moteur de croissance mondiale.